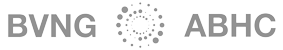Quarante ans d’histoires et de croisements. Entretien avec Xavier Rousseaux
Camille Banse, UCLouvain
Xavier Rousseaux est né à Bruxelles en 1957. Il est licencié-agrégé en histoire (1982), bachelier en philosophie (1983), licencié en communication et maître en sociologie en 1987, docteur en histoire trois ans plus tard. Directeur de recherche du FNRS et professeur extraordinaire à l’UCLouvain, Xavier Rousseaux a été enseignant dans le secondaire (1982-1984), aspirant FNRS (1985-1989), assistant en sociologie aux FUSL de 1989 à 1995. Enfin, après un mandat de chargé de recherche (1990) il devient chercheur qualifié au FNRS à l’UCLouvain (1992), puis professeur invité aux Universités de Bruxelles, du Luxembourg et d’Angers. Chargé de recherche invité au CNRS (1992-1993), Research Fellow du NIAS Wassenaar (1998-1999) et de l’IEA (2015-2016), il est également directeur d’études invité à l’EHESS à Paris (2020).
Vous commencez vos études à l’université en 1977. Quel était le statut de l’historien·ne à ce moment-là ?
Mon entrée comme étudiant en histoire date de septembre 1977. J’arrive aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur (actuellement l’UNamur. Un des rares Bruxellois, je m’intègre dans un groupe de 40 inscrits venant de toute la Wallonie. C’était l’époque de l’« history from below » dans le monde anglophone, et de la « nouvelle histoire » en France dont notre mentor René Noël était un excellent représentant. Être historien, c’était comprendre la société. Parmi nos lectures de chevet : Montaillou de Le Roy-Ladurie1 et Surveiller et punir de Michel Foucault2. Après deux années d’immersion dans un département d’histoire jeune et bouillonnant, arrivée à Louvain-la-Neuve en même temps que la Faculté de Lettres. Les candidats francophones affluent de Leuven, de Bruxelles (Saint-Louis) et de Namur ; comme leurs professeurs, ils découvrent un nouveau site – Louvain-la-Neuve – pour une « fusion » avant l’heure. J’y perds mon promoteur, Joseph Ruwet, patron de l’histoire moderne, et j’y rencontre une historienne marginale et engagée à la Faculté de Droit, Sylvette Dupont. Pour ces deux figures marquantes René Noël à Namur et Sylvette Dupont à Louvain-la-Neuve, l’historien avait une fonction sociale : celle d’éclairer les débats contemporains par une réflexion intellectuelle, une distance critique, et une mise au contexte des discours en particulier par l’observation des pratiques sociales. Mieux que le bourgeois, le pape ou le souverain, le révolté, la sorcière et le marginal permettaient de comprendre la société, par les marges.
Comment vous tournez-vous vers un doctorat ?
Les candidatures à Namur m’avaient ouvert à la passion pour l’histoire. Les licences à Louvain-la-Neuve m’invitaient à la dispersion vers les sciences humaines (philosophie, communication, socio-anthropologie, économétrie…). J’ai pris le temps – un an supplémentaire – pour digérer cela dans mon mémoire sur la Criminalité en temps de guerre et société de violence 3 tout en commençant une licence en communication et un diplôme en sociologie. Une rencontre déterminante fut le cours de Michel Foucault sur l’Aveu4, que j’ai pu suivre comme étudiant, grâce à Sylvette Dupont. La découverte des archives judiciaires, voie d’accès aux « muets de l’histoire », allait m’orienter vers l’histoire sociale. À le relire aujourd’hui ce mémoire concentrait les thèmes (le crime, la guerre, la société, la violence…) que j’ai creusé dans ma thèse et mes travaux de recherche. Après deux années d’enseignement secondaire (beaucoup de sciences religieuses, un peu d’histoire), j’obtiens un mandat d’aspirant FNRS en 1984. Entretemps, il me restait dix mois de service militaire à donner à la Patrie. Neuf mois à l’École Royale Militaire comme de temps de gestation du projet doctoral. J’y ai découvert la micro-informatique, le terrorisme des Cellules communistes combattantes, et publié quelques articles. Quatre années et demie de doctorant plus tard, je défends ma thèse de doctorat Taxer ou châtier ? 5 en février 1990, dans un contexte climatique et institutionnel orageux. Entretemps, une institution sociale méconnue, la justice, était devenue centrale dans mes recherches à l’instar de sa place dans une Belgique en désarroi … Car la voix de marginaux passait par le filtre de la police, des tribunaux, des prisons…. Et la justice belge sortait de l’ombre avec les grandes affaires des Tueurs du Brabant, du Heysel, ou de l’affaire des « petites filles ».
Le temps du doctorat était un temps bien rempli : il faut dire qu’à l’époque, c’est 4 à 5 jours d’archives par semaine, de nombreux colloques avec ma « patronne », des travaux pratiques d’histoire en première candidature en droit, sans oublier une maitrise en sociologie et un mémoire en communication6. La dispersion demande une bonne discipline. À l’époque, pas d’école doctorale, pas de rapports bureaucratiques, pas de crédits à accumuler. Pas de téléphone, pas de comité de thèse, à peine un bureau… c’est l’isolement.
Heureusement, autour de la KBR et des archives générales du Royaume qui conservaient l’essentiel de mes sources, gravitaient de nombreuses étudiantes et étudiants de toutes les universités du pays. Ma madeleine de Proust a la saveur des sandwiches desséchés (au fur et à mesure de la semaine), mais pas chers, du 5e étage de la KBR. Repas frugal partagé à la table des « francophones » et celle des « flamands », parfois mélangés en une table bilingue au gré des affinités intellectuelles ou affectives ! (sourire) Autour d’une bande de doctorant·es et des premier.es chercheur·euses sous contrat (Cadres spéciaux temporaires) s’est développé un Groupe interdisciplinaire en Sciences humaines où nous pouvions présenter et discuter nos résultats et ainsi préparer notre défense. Nombre des membres sont devenus des collègues.
Racontez-moi l’aventure du CHDJ.
Le Centre d’histoire du droit et de la justice (CHDJ) est né grâce à Sylvette Dupont, qui a réuni ses premières étudiantes en 1990-92 pour un groupe de recherche informel, le Groupe d’histoire des institutions pénales et pénitentiaires. L’arrivée d’un assistant en histoire et en droit, plus ma nomination comme chercheur permanent du FNRS à l’UCL a permis à Sylvette Dupont et des collègues juristes de proposer un centre interfacultaire, entre droit et histoire, dès 1992. Celui-ci n’a pas été accepté, et le CHDJ est devenu un groupe de recherche « sans cadre ni budget » au département d’histoire. Officiellement « baptisé » à l’abbaye de Bonne-Espérance en 1995, il est devenu unité du département en 2001 puis laboratoire d’excellence du FNRS, et enfin centre de recherche en 2009. Son histoire se lit à travers ses pérégrinations géographiques. D’abord installé dans les bureaux du collège Thomas More en faculté de droit, puis renvoyé au collège Érasme/Descamps puis enfin relocalisé à la maison Challenge de la rue du Poirier dans la zone des sciences et technologies … À travers les vicissitudes de la recherche, ce centre a cultivé quatre caractéristiques. Il est un espace transpériode avec des historien·nes médiévistes, modernistes et contemporanéistes en constant dialogue ; un lieu pluridisciplinaire où l’approche historienne cimente des expertises juriste, politologue, socio-anthropologue, archéologue, criminologue, communicationnelle, démographe… ; il héberge une pépinière de chercheur·euses impliqué·es dans les enseignements en premier, second et troisième cycle, ainsi que de nombreux étudiant·es, mémorant·es, jobistes ou stagiaires. C’est enfin un laboratoire ouvert sur la communication avec sa collection Histoire, justice et société, et les séries estivales d’histoire criminelle dans les médias francophones.
Comment fondez-vous la revue Crime, histoire et sociétés ?
Une chance déjà comme étudiant, toujours grâce à Sylvette Dupont est d’avoir pu participer à la naissance d’un groupe international d’histoire du crime et de la justice (IAHCCJ) très actif depuis 1977. Ce groupe se réunissait tous les ans à la Maison des Sciences de l’Homme, à Paris, boulevard Raspail, pour des ateliers d’un jour et demi, en anglais et français. C’était sérieux avec des textes précirculant à l’avance par la poste (il fallait quand même compter trois semaines de délai !), et publiés en Newsletter ensuite. C’était convivial à la brasserie « Le Raspail », l’« annexe » où se poursuivaient les discussions. Évidemment, c’était idéal pour développer le réseau d’un jeune chercheur … Transpériode, pluridisciplinaire et international, le groupe décide en 1997 de transformer cette Newsletter en revue. J’ai eu la chance de travailler avec l’équipe intergénérationnelle de la revue qui a fêté ses vingt ans par un double numéro spécial sur le futur de l’histoire du crime.
Votre expertise est transpériode et vous enseignez dans plusieurs facultés, pensez-vous que ces croisements soient féconds ?
Sur un plan personnel, naviguer entre Droit, Sciences sociales et Lettres, c’est exigeant. Il faut entrer dans les approches de chaque discipline, et les sous-cultures de chaque période historique. Pour les étudiant·es, la démarche oblige à sortir de sa zone de confort ; certain·es aiment, d’autres non. Petit avantage, être historien·ne en droit, crimino ou socio, cela fleure bon l’exotisme.
En revanche, du point de vue institutionnel, les entreprises pluridisciplinaires sont à la fois les plus passionnantes et les plus fragiles, car elles ne sont pas institutionnalisées aussi fortement que les disciplines plus propices aux permanences identitaires. En fin de compte, l’Université reste assez traditionnelle.
Quels sont les grands changements auxquels vous avez assisté à l’université ? Je pense à la féminisation du monde académique, les changements dans le parcours doctoral, …
Mon expérience de féminisation est particulière, ayant été dirigé par une femme, non académique et féministe. J’ai eu la chance de continuer à travailler avec ma « patronne » comme collègue, elle m’a sensibilisé aux développements de l’Université de femmes, au CARHIF en passant le GRIEF devenu GREG à l’UCLouvain. Il s’agissait d’intégrer les dynamiques de genre comme une méthode et surtout pas un objet parmi d’autres !
Sur la politisation des étudiants, j’observe que les grandes mobilisations des années 1980 ont cédé la place à des mouvements plus discrets et éclatés, peut-être plus agressifs, plus clivants. L’impression est plutôt à une polarisation des discours qui glissent vers la mauvaise foi et l’intolérance. Mais la tendance qui m’inquiète plus c’est l’individualisme qui cache souvent un consumérisme croissant, y compris dans l’évaluation scientifique.
Sur le doctorat, pour avoir été président de commission doctorale, je suis sceptique devant l’inflation des formalités doctorales au détriment des activités de recherche. Ici deux conceptions s’affrontent : le doctorat comme expérience, souvent fondé sur le modèle ancien du maître/disciple empreint de paternalisme ou de domination, mais fondé sur une relation personnelle de transmission du savoir. Le doctorat comme contrat où la relation superviseur-doctorant devient professionnelle et les interactions s’inscrivent dans des rapports de travail formalisés. Personnellement je préfère les dynamiques collectives, entre doctorant·es, dans les équipes de recherche et autour des comités d’accompagnement de thèse, qui accompagnent autant le promoteur·ice que le doctorante ou la doctorante.
Sur les langues aussi. Comme étudiant francophone, il était important de fréquenter l’historiographie et les spécialistes néerlandophones. Faire l’histoire du Brabant, des Pays-Bas ou de Belgique supposait de lire une majorité de contributions en néerlandais. D’où l’intérêt des tables de conversation à la KBR ! Dès les années 1980, l’anglais devient la « lingua franca » du monde universitaire. Mais la spécificité des sciences humaines, c’est l’irréductibilité de l’expression des résultats à une seule langue, qui plus est à fonction de communication basique. J’ai donc été amené à écrire dans les trois langues que je maitrise le moins mal. Et j’essaie de lire des contributions marquantes dans quelques autres … ce qui me rend très humble et admiratif devant ces chercheurs polyglottes, souvent les meilleurs remparts contre les dictatures toujours fascinées par l’unilinguisme.
J’ajoute qu’en quarante ans, la révolution numérique profondément transformé les relations de savoir, donc le travail de l’historien. Je repense à mon mémoire tapé à la machine à écrire sur base de milliers de fiches papier, à ma thèse fondée sur des dépouillements en dBase II et imprimée sur une imprimante à laser. Les années 1980 à l’Université, c’était les syllabi papier, les notes de cours photocopiées, les exercices informatiques sur carte perforée (quand ça marchait !), les travaux en retard portés à l’adresse privée des profs (éditée dans l’annuaire de l’Université). En 2000, pour les exercices de sciences sociales créés avec une collègue géographe, on utilisait des « transparents » et des documents photocopiés ; les bases de données devaient tenir sur des disques 3 ½ de 720k, et les travaux étaient imprimés. Ça n’a plus rien à avoir avec aujourd’hui.
L’année de votre accès à l’éméritat, vous souhaitez-vous transmettre aux historien·nes en herbe ?
J’ai rencontré beaucoup d’étudiant·es passionné·es par l’histoire mais désabusé·es à l’idée de ne pouvoir en faire leur métier. Tout le monde peut s’affubler du titre d’historien·ne dans les médias, ce qui n’est pas le cas pour nos collègues juristes, ingénieures ou médecins. À ma sortie de deuxième cycle en 1982, 60 % des diplômés en histoire se dirigeaient vers l’enseignement secondaire. À l’époque, la crise économique rattrapait les écoles qui licenciaient leurs temporaires. Aujourd’hui, les historien·nes sont partout reconnu·es pour des expertises spécifiques. Leur chance c’est d’apporter aux mondes professionnels ce qui manque dans des formations plus immédiates : la rigueur de l’information, la capacité de recherche, d’analyse et de synthèse, sans oublier le constant rappel du passé (invisible) inscrit dans le présent… Qui plus est, la formation historienne laisse une trace particulière … elle bonifie avec le temps.
Webreferenties
- UCLouvain: https://uclouvain.be/fr/index.html
- FUSL: https://www.usaintlouis.be/
- Bruxelles: https://www.ulb.be/
- Luxembourg: https://wwwen.uni.lu/
- Angers: https://www.univ-angers.fr/fr/index.html
- NIAS Wassenaar: https://nias.knaw.nl/
- IEA: https://www.paris-iea.fr/fr/
- EHESS: https://www.ehess.fr/fr
- UNamur: https://www.unamur.be/
- Sylvette Dupont: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/incal/chdj/actualites/hommage-a-sylvette-dupont.html
- KBR: https://www.kbr.be/nl/
- archives générales du Royaume: https://search.arch.be/fr/
- Centre dâhistoire du droit et de la justice (CHDJ): https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/incal/chdj
- Histoire, justice et société: https://pul.uclouvain.be/collection/?collection_id=64
- IAHCCJ: https://www.h-net.org/~iahccj/
- double numéro spécial: https://journals.openedition.org/chs/1740
- Université de femmes: https://www.universitedesfemmes.be/
- CARHIF: https://avg-carhif.be/nl/accueil-nederlands/
- GREG: https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/greg
Références
- E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, Gallimard, 1975 (Bibliothèque des histoires).
- M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 (Bibliothèque des histoires).
- X. Rousseaux, Criminalité en temps de guerre et société de violence. Nivelles (1646-1695), mémoire inédit, Louvain-la-Neuve, UCL, 1982.
- M.Foucault, Mal faire, dire vrai : fonction de l’aveu en justice. Cours de Louvain, 1981, (F. Brion, B.H. Harcourt, eds), Chicago/Louvain-la-Neuve, U. of Chicago Press/Presses Universitaires de Louvain.
- X. Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), thèse inédite, Louvain-la-Neuve, UCL, 1990.
- X. Rousseaux, Violences et incrimination, un « coq de village » avant et après 1726, thèse de maîtrise en sociologie, Louvain-la-Neuve, UCL, 1987. Id., Le passé recomposé. Trois essais sur histoire et communication, mémoire de licence en communication sociale, Louvain-la-Neuve, UCL, 1987.